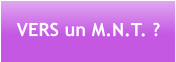L’identification
des
formations
végétales
et
les
vérifications
de
terrain
ont
été
faites
entre
septembre
1979
et
septembre
1982.
27
formations
végétales
élémentaires
ont
été
reconnues
dont
17
sont
dans
les
plaines
d’inondation
et
les
rizières
du
Delta,
3
dans
les
plaines
lacustres
du
nord
et 7 sur les îles, berges et hautes plaines non submergées.
Méthodologie des observations de terrain
et traitement de l’information
La
modélisation
du
milieu
naturel
s'appuie
sur
la
carte
des
pâturages
du
Delta
intérieur
du
Niger
réalisée
par
l’équipe
CIPEA/ODEM
comme
expliqué
dans
l’historique
du
projet.
Elle
couvre
les
plaines
de
la
cuvette
du
Niger
depuis
Ké
Macina
(sur
le
Niger)
et
Baramandougou
(sur
le
Bani),
en
amont,
jusqu'au
lac
Débo
en
aval,
y
compris
une
fraction
du
Farimaké
au
nord-ouest
du
Lac
Débo,
soit
une
superficie
un
peu
supérieure
à
22
000
km².
Cette
carte,
ainsi
que
les
études
qui
l'accompagnent,
devait
servir
à
un
plan
d'aménagement
régional
avec
la
création
d'association
d'éleveurs
ou
d'agro-pasteurs.
Cette
perspective
a
déterminé
le
niveau
de
précision
recherché
dans
la
définition
des
thèmes
cartographiques,
l'échelle
des
levés
et
de
la
restitution
cartographique
au
1:50
000.
Il
ne
s'agit
donc
pas
d'une
échelle
cadastrale
mais
d'une
échelle
très
détaillée
et
suffisante
(la
superficie
des
plus
petites
unités
cartographiées
étant
d'environ
1
ha)
pour
une
modélisation
de
l'écosystème
régional,
étape
indispensable
dans
le
processus
conduisant à une meilleure compréhension des enjeux spatiaux pour l'usage et l'appropriation des ressources dans le Delta.
LES RELEVÉS DE TERRAIN
Pour
plus
de
détails,
le
lecteur
se
reportera
aux
travaux
de
Hiernaux
et
al.
(cités
en
bibliographie)
et
aux
données
à
télécharger.
Nous
ne
donnerons
ici
que
le
minimum
d'indications
permettant
de
comprendre
la
méthode
mise
en
œuvre
:
l'inventaire
des
ressources
fourragères
du
Delta
est
établi
sur
une
base
phyto-écologique.
Les
caractéristiques
purement
fourragères
de
productivité
des
parcours,
composition
bromatologique,
sensibilité
à
la
pâture….etc,
sont
rapportées
à
une
vingtaine
de
types
de
parcours
définis
par
une
étude
phyto-écologique
préalable.
Les
types
de
parcours
sont
définis
à
la
fois
par
les
caractéristiques
de
leur
végétation
:
composition
floristique
et
structure
biomorphologique,
et
par
celles
du
milieu
auquel
ils
sont
liés
:
position
topographique
et
géomorphologique, sol, régime d'inondation, mode d'exploitation pastorale…
L'inventaire
et
l'analyse
phyto-écologique
ont
été
menés
sur
169
sites
de
100
m²
chacun,
127
consacrés
aux
parcours
des
plaines
submersibles,
8
aux
casiers
rizicoles
de
l'Office
du
Niger
et
34
autres
aux
replats
et
reliefs
non
submersibles
du
Delta.
La
pratique
du
relevé
méthodique
et
simultané
des
caractères
de
la
végétation
et
du
milieu
s'inspire
très
largement
de
la
méthode
mise
au
point
par
les chercheurs du CNRS – CEPE Louis Emberger – (M. Godron et al., 1968, Ph. Daget et al., 1970).
Outre
les
mesures
de
masse
végétale
qui
accompagnent
chaque
relevé
phyto-écologique,
douze
sites
ont
été
consacrés
aux
mesures
de
production
(un
enclos
grillagé
de
1000
à
1500
m²
est
installé
au
cœur
de
chacun
des
sites
choisis).
Mesures
et
traitements
ont lieu dans les enclos, donc sur des pâturages soustraits à la pâture.
Les principales mesures effectuées dans les enclos sont les suivantes:
•
évolution saisonnière et interannuelle de la masse et de la production végétale en situation de mise en défens.
•
mesure de l'effet d'une fauche et d'un incendie, pratiquée plus ou moins précocement, sur la repousse de l'herbe.
•
effet
de
plusieurs
rythmes
de
fauches
répétées
(après
fauche
ou
incendie
initial),
sur
la
production
des
repousses
en
saison
sèche.
•
essais de fenaison, d’époque de coupe, et mode de conservation.
En
outre,
dans
trois
des
12
sites
précédents,
un
parcours
balisé
de
plusieurs
hectares
est
associé
à
l'enclos.
Un
suivi
de
la
fréquentation
du
bétail
permet
d’estimer
la
charge
animale
saisonnière.
La
masse
de
l’herbe
est
suivie
dans
le
parcours
mais
aussi
à
l’intérieur de cages mobiles déplacées chaque 15 jours afin de mesurer la repousse de l’herbe sous pâture.
LE TRAITEMENT DE L
'
INFORMATION
Comme
pour
la
technique
des
relevés,
l'analyse
des
données
utilise
la
procédure
de
calculs
préconisée
par
les
chercheurs
du
Centre
d'
É
tudes
Phytosociologiques
et
É
cologiques
Louis
Emberger
(CNRS
Montpellier)
où
les
calculs
ont
été
réalisés.
Deux
démarches
sont
associées
:
l'une
plus
analytique
avec
l'établissement
des
profils
écologiques
des
espèces
pour
les
principales
variables
écologiques,
l'autre
plus
synthétique
pour
les
analyses
factorielles des correspondances qui sont effectuées sur les matrices "espèces-relevés" et surtout "espèces –états de variables" .
Pour
chaque
formation
végétale,
la
flore,
l’écologie
et
la
production
végétale
et
fourragère
annuelle
et
saisonnière
sont
caractérisées
sur
la
base
d’informations
recueillies
systématiquement
sur
169
sites
(393
taxons
et
119
variables
écologiques).
L’analyse
statistique
de
ces
données
a
permis
d’établir
les
profils
floristiques
et
écologiques
de
chaque
type
de
végétation.
Il
s’agit
de
profils
dits
‘indicés’,
dans
lesquels
l’indication
portée
pour
chaque
classe
de
la
variable,
ou
taxon
considérée,
est
un
seuil
de
probabilité
de
présence
ou
d’absence
(de
la
formation
végétale
dans
la
situation
correspondant
à
la
classe
de
la
variable,
ou
de
l’espèce
dans
la
formation
végétale).
La
méthode
dite
"des
profils
écologiques
indicés"
est
décrite
dans
un
article
fondateur
cosigné
par
B.
Gauthier,
M.
Godron,
P.
Hiernaux
et
J.
Lepart,
«
Un
type
complémentaire
de
profil
écologique
:
le
profil
écologique
‘indicé’
»
, Journal canadien de botanique, 1977, Vol. 55, pp. 2859-2865.
Il
s’agit
"d’analyser
une
collection
de
relevés
phyto-écologiques
prenant
en
compte
la
présence
d’espèces
végétales
et
d’un
certain
nombre
de
variables
caractérisant
le
milieu".
Concrètement,
un
test
permet
de
calculer
la
sensibilité
de
l’espèce
végétale,
ou
de la formation végétale considérée, à l’état de la variable. Cinq cas de dépendance sont relevés et codés dans la base de données.
*
MB
La
mosaïque
des
berges
n'est
pas,
à
proprement
parler,
une
association
végétale,
mais
une
mosaïque
complexe,
"raccourci"
de
différentes
formations
inondées
(VB,
B,
O,
VOR,
VSP,
VH,
AG,
ZB).
Elle
se
situe
en
bordure
du
lit
mineur,
sur
les
faisceaux
de
levées
et
chenaux
alluviaux
qui
occupent
le
lit
majeur
du
Niger,
du
Bani
et
de
leurs
principaux
défluents.
Ses
principales
caractéristiques
font
l'objet
d'une
fiche
spécifique,
mais
ne
sont
donc
pas
déterminées
par
calcul
comme
les
autres mosaïques.
LA PHOTO-INTERPR
É
TATION ET LA CARTOGRAPHIE
La
cartographie
a
été
réalisée
à
partir
d'une
photo-interprétation
de
la
couverture
75
MAL
32/500
clichés
23x23
cm
panchromatique
et
IRC
-
infrarouge
couleur
-
au
1:50
000
complétée
localement
par
les
couvertures
74
MAL
20/500
pour
le
sud-ouest
et
70/71
AO
891/500
pour
la
rive
est.
Au
cours
des
prospections
initiales,
la
correspondance
entre
la
nature
de
la
formation
végétale
et
celle
du
milieu
topo-géomorphologique
était
établie
au
cas
par
cas,
avec
leurs
aspects
sur
les
photos
aériennes.
Mark
Haywood
a
ensuite
procédé
à
la
photo-interprétation
sous
stéréoscope
à
très
fort
grossissement,
délimitant
les
formations
végétales
reconnues.
Le
report
des
limites
est
fait
à
main
levée
sur
un
fond
topographique
issu
des
cartes
de
l'Institut
Géographique
National
(I.G.N.)
et
de
l'Organisation
Internationale
contre
le
Criquet
Migrateur
Africain
(O.I.C.M.A.),
agrandi
par
la
méthode
des
grilles
kilométriques.
Les
vérifications
de
terrain
ont
été
effectuées
par
Pierre
Hiernaux,
Lassine
Diarra
et
Mark
Haywood.
Sur
ses
cartes
des
pâturages,
Mark
Haywood
ne
reporte
que
les
formations
végétales,
ne
tenant
pas
compte
des
surfaces
cultivées
dont
l’emplacement
et
l’étendue
varient
d’une
année
sur
l’autre.
Les
surfaces
cultivées
seront
cartographiées
dans
un
autre
travail
et
publiées
à
part.
En
effet,
sur
les
photos
aériennes,
en
infrarouge
notamment,
on
peut
"lire"
les
formations
végétales
sous
le
parcellaire
de
culture
qui,
rappelons-le,
même
en
riziculture,
est
un
système
de
culture
temporaire
avec
jachère.
Cette
particularité
nous
sera
très
précieuse
pour
déterminer
quelles
formations
végétales
ont
été
défrichées
à
diverses
époques.
Cependant,
une
telle
lecture
est
impossible
dans
les
casiers
rizicoles
aménagés
où
toute
trace
de
la
formation
végétale
antérieure
a
disparu.
C'est
le
cas
des
casiers
de
l'Office
du
Niger
qui
sont
codés
R,
à
l'instar
d'une
formation
végétale.
BP,
B
et
VB
constituent
les
bourgoutières
et
vétivéraies
très
profondes,
PAK
correspond
à
une
vétivéraie
très
profonde
à
Acacia
Kirkii
et
PAM
à
des
chenaux
et
plaines
basses
à
Mitragina
inermis
.
OP,
O
représentent
les
orizaies,
VOR
et
EOR,
les
vétivéraies
et
éragrostaies
profondes,
VSP
et
ESP,
les
vétivéraies
et
éragrostaies
moyennes,
VH
et
AC
les
vétivéraies
et
éragrostaies
en
position
haute,
P
et
ZB
les
panicaies
et
la
zone
de
battement
des
crues
maximales.
AG
est
une
savane
à
Andropogon
gayanus
faiblement
inondée
et
les
formations
allant
de
TA
à
TT
sont
des
formations
"sèches"
qui
ne
sont
donc
pas
normalement
touchées
par
l'inondation.
Elles
se
situent
sur
les
marges
sèches
et
sur
les
"
togge
(sg.
toggere
)",
nom
traditionnel
des
buttes
exondées
dans
le
Delta.
PAN,
PAS,
PAR
représentent
des
formations
végétales
localisées
sur
des
plaines
à
submersion
différée
où
l’inondation,
très
irrégulière,
est
liée
au
ruissellement
local
en
saison
des
pluies,
puis,
en
fin
d’année,
à
la
crue
qui
remonte
de
l’aval
dans
les
chenaux
de
la
zone
lacustre.
On
les
trouve
principalement
dans
le
Farimaké.
Une
zone
élémentaire
cartographiée
représente
donc
une
des
27
associations
végétales
élémentaires
(28
avec
la
mosaïque
MB)
indiquées
sur
la
carte
par
son
sigle
ou,
plus
souvent,
une
mosaïque
représentant
un
gradient
le
long
d'une
pente
ou
de
petites
ondulations
de
terrain
qui
se
traduisent
par
des
variations
faibles,
mais
significatives,
des
conditions
d'inondation
sur
une
surface
réduite.
La
photo-interprétation,
dans
certains
cas,
aurait,
certes,
permis
de
séparer
les
associations
constituantes
des
mosaïques,
mais
la
petite
taille
des
unités
aurait
rendu
la
carte
très
difficilement
lisible.
Dans
le
reste
du
texte,
l'expression
"formation
végétale"
est
le
terme
générique.
L'expression
"association
végétale"
désigne
les
formations
de
base
identifiées
par
Pierre
Hiernaux.
Elles
sont
toujours
identifiées
par
un
sigle
composé
de
une
à
trois
lettres,
comme
le
montre
le
tableau
précédent.
Nous
désignerons
par
l'expression
"mosaïque
végétale"
les
formations
végétales
composites.
Elles
sont
toujours
identifiées
par
un
sigle
lui-même
composite
dont
les
deux
éléments
constitutifs
sont
séparés
par
un
slash.
Ainsi
O/VOR
est
une
mosaïque
dont
les
éléments
constitutifs
sont
les
formations
végétales
O
et
VOR.
Les
modalités
de
calculs
de ces mosaïques seront exposées dans la partie consacrée aux bases de données sur la végétation.
Enfin,
l'information,
pour
chaque
association
végétale,
est
regroupée
en
trois
sections
:
floristique,
écologique
et
production.
Ces
trois
sections
ont
été
conservées
dans
l'architecture
des
bases
de
données
et
correspondent
à
une
collection
de
fiches
(pdf)
et
à
des tables.


Tableau n° 2 : Les associations végétales du Delta Intérieur
Tableau n° 1 : Codes représentant l’intensité des liaisons espèces/profil floristique ou profil/état de la variable
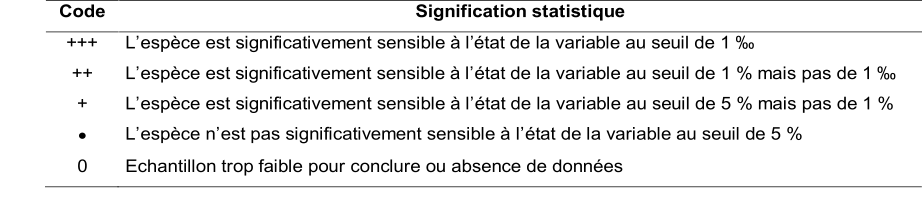

** On appelle Togge (singulier Toggere) en langue Peule (fulfulde) les buttes normalement exondées dans le Delta et ses bordures.